
Histoire des coureurs de bois. Amérique du Nord, 1600-1840 de Gilles Havard aux Indes savantes, « Rivages des Xantons – Mondes atlantiques », 2016, 870 p. ISBN : 978-2846544245 Prix : 35 €.
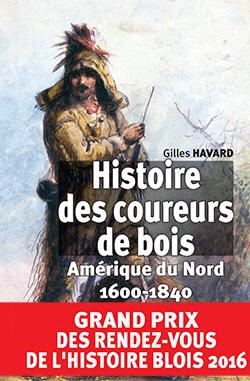
Présentation de l’éditeur :
« Coureurs de bois, voyageurs, traiteurs, hommes du Nord, mangeurs de lard, hommes libres, chasseurs des montagnes : ces appellations pittoresques témoignent d’une Amérique oubliée, celle d’avant la conquête de l’Ouest. D’origine européenne, les hommes qu’on désignait ainsi sillonnaient le Nouveau Monde en quête de pelleteries, séjournant et parfois hivernant parmi les Amérindiens. De la Caroline du Sud au Mississippi, de la vallée du Saint-Laurent aux Rocheuses, ils formaient des sociabilités itinérantes et masculines, étroitement associées aux communautés autochtones. Restituer leurs circulations, c’est repenser la construction des sociétés coloniales dans leur rapport à l’espace, à l’ordre et à l’altérité, et mettre au jour des expériences singulières de la masculinité, comme d’une certaine forme de liberté. Suivre leurs traces, c’est aussi donner à comprendre les voies multiples de l’indianisation et du métissage et rendre compte d’une Amérique insolite où se côtoient langue de Molière et langues amérindiennes. Dans la perspective de l’anthropologie classique, Histoire des coureurs de bois ouvre par ailleurs une fenêtre sur d’autres formes de rationalité, qu’il s’agisse des pratiques d’échange, des lois de l’hospitalité, des relations entre les sexes (y compris les plus intimes), ou encore des fondements de la violence au sein des sociétés amérindiennes.
Le lecteur est ainsi convié au dévoilement d’une aventure interculturelle intense et méconnue, longue pourtant de deux siècles et qui s’est jouée sur tout un continent. »
L’auteur :
Gilles Havard est historien, directeur de recherche au CNRS. Ses travaux portent sur l’histoire des relations entre Européens et Amérindiens en Amérique du Nord (XVIe-XIXe siècle). Son dernier livre, Histoire des coureurs de bois (Amérique du Nord, 1600-1840), a été publié en février 2016 aux Indes Savantes. Il a aussi publié The Great Peace of Montreal of 1701 (Mc Gill Queens University Press, 2001), Empire et métissages. Indiens et Français dans le Pays d’en Haut, 1660-1715 (Septentrion/PUPS, 2003) et co-écrit Histoire de l’Amérique française (Flammarion, 2003 ; 3 rééd.).
Le lecteur intéressé pourra compléter cette lecture avec Un continent en partage. Cinq siècles de rencontres entre Amérindiens et Français. (2013). Sous la direction de Mickaël Augeron, Gilles Havard, 2013, 644 pages. ISBN : 978-2-84654-356-9. Prix : 39,00 €.

Présentation de l’éditeur :
Un arrière-petit-fils du chef apache Geronimo qui vient se recueillir sur les plages du Débarquement ; des Indiens de Louisiane qui reçoivent une délégation de sénateurs français dans la langue de Molière ; un Arikara du Dakota du Nord qui se déclare « Frenchman » ; des indianophiles français qui, le week-end, vivent sous un tipi… Pour rendre compte de la variété et de la densité de ces instantanés du temps présent, il faut s’immerger dans la riche et longue histoire des relations entre Français et Amérindiens. Cet ouvrage collectif, où se joue le récit d’un continent en partage, entrecroise plusieurs thématiques : l’histoire coloniale française, des premiers voyages d’exploration du Nouveau Monde aux exhibitions de « Sauvages » sous la IIIe République, en passant par l’aventure de la Nouvelle-France ; les périples d’Amérindiens sur le sol français, du XVIe siècle à nos jours ; le rôle de l’américanisme dans la réflexion ethnologique française, de Jean de Léry à Claude Lévi-Strauss ; les héritages linguistiques, littéraires ou philosophiques des rencontres franco-indiennes ; la mémoire contemporaine qu’ont les autochtones d’Amérique du Nord de leurs alliances avec les Français ; ou encore la place des citoyens amérindiens de Guyane dans la République française. Se dégage au final une peinture souvent inattendue d’itinéraires et de destins croisés qui nous transporte de la France aux Amériques indiennes sur une période de cinq siècles.
Source : Les Indes savantes

Laisser un commentaire